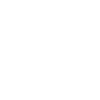À PROPOS DU MARTYR DES MOUSSES
Beaucoup de contrevérités ont été écrites sur les mousses et leurs conditions d’existence à bord des navires de commerce. Les récits de naufrages spectaculaires et de mousses martyrisés alimentaient une certaine littérature de gare qui avait cependant au moins l’avantage de sensibiliser les campagnes sur les problèmes maritimes en faisant vibrer les cœurs dans les chaumières.
En 1901, Léopold Aujar publie un roman Mousse. La vie au long-cours qui fait couler beaucoup d’encre, dans lequel il dépeint l’existence misérable des enfants embarqués au Commerce, battus tous les jours. La presse écrite, reprenant à son compte le récit de Léopold Aujar dénonce les parents inhumains qui jettent leur enfant sur les bâtiments marchands où il est l’universel souffre-douleur. Tout le monde le commande, il ne sait pas à qui obéir et les coups pleuvent sur le malheureux qui ne peut satisfaire tout l’équipage en même temps. Frappé à coups de garcette, mis aux fers à fond de cale avec les rats… Il n’en faut pas plus aux journalistes pour clamer haut et fort que ce serait une œuvre humanitaire que de supprimer les mousses à bord des navires marchands.
La Revue Générale de la Marine Marchande dirigée à l’époque par Léon Muller, un capitaine au long-cours s’indigne de cette présentation romanesque et fallacieuse des conditions d’existence des mousses du Commerce et de la Pêche et tente de rétablir la vérité. La vie du mousse n’est pas la même sur tous les navires. Il faut envisager séparément les bateaux de pêche, les petits caboteurs (lougres, sloops, goélettes ou petits bricks), les voiliers long-courriers et les vapeurs. La pêche est généralement la première école du mousse et il est bien rare que les petits Bretons qui embarquent à ce titre à bord des long-courriers n’aient pas été pêcheurs. C’est à la pêche qu’ils font l’apprentissage de leur futur métier. Là, le mousse n’est pas frappé car généralement les bateaux pêcheurs sont armés par des hommes qui se connaissent déjà entre eux, qui sont parents quelquefois, et il arrive assez souvent que le patron est en même temps chef de famille. Alors c’est au père que la mère confie son enfant pour le rude apprentissage et si ce dernier est élevé durement, en tout cas il n’est pas maltraité. C’est dans la seconde catégorie de navires, ceux qui font le cabotage, que les mousses mènent l’existence la plus pénible. Le capitaine, maître au cabotage ou patron au bornage, est assez souvent un homme rude, sans instruction, un ancien matelot arrivé à la longue au commandement. Imbu d’une autorité dont il est jaloux à l’excès, ayant été élevé durement lui-même, il trouve tout naturel que les autres le soient à leur tour. Si, par surcroît cet homme a l’habitude de boire, alors sa dureté ne connaît plus de bornes.
Sur ces navires, l’équipage est réduit à l’extrême et il arrive qu’on demande au mousse le labeur d’un homme. L’existence que mènent les marins du cabotage est très pénible. L’obligation de veiller sans cesse à cause des dangers et des nombreux navires qui atterrissent ou prennent le large, les coups de vent essuyés avant de pouvoir se mettre à l’abri, cette existence de misère et de labeur incessant rend ces hommes insensibles. À bord des caboteurs, la principale fonction du mousse est de faire la cuisine. Sur l’avant du bateau, dans une pauvre cabane, sur un petit fourneau, le mousse fait chauffer les aliments de l’équipage, ce qui ne l’empêche pas de donner la main à la manœuvre. Quand celle-ci est difficile pendant les mauvais temps, le mousse, obligé de laisser ses casseroles pour aller aider à serrer de la toile, trouve souvent à son retour la cuisine inondée par un paquet de mer, son fourneau éteint et, lorsque la manœuvre terminée, l’équipage vient réclamer sa pitance au cuisinier qui lui déclare qu’elle a filé par les dalots, c’est sur son dos que les hommes font passer leur colère. Les mousses qui ont subi de mauvais traitements au cabotage quittent bientôt leur navire pour réaliser leur rêve : embarquer à bord des voiliers long-courriers ou des vapeurs. Sur ces navires nécessairement commandés par des capitaines au long-cours secondés souvent par un véritable état-major, où un cuisinier est embarqué, les mousses ne sont plus maltraités. Ici, en dehors de la manœuvre, le service du mousse consiste à balayer le pont, nettoyer les cages à poules, soigner les bêtes, gratter la rouille, piquer les tôles, apporter à l’équipage, aux heures de repas, les rations qu’il va chercher à la cuisine. C’est peut-être au port que son travail est le plus éprouvant. Sur les voiliers équipés de chaudières, les mousses sont employés à la conduite des treuils à vapeur. Ils rendent alors les services d’un matelot et c’est là pour le mousse une tâche pénible, dans les pays chauds surtout comme le Chili, que de rester une journée entière en plein soleil, debout devant son moteur brûlant de vapeur, obligé d’apporter à son poste une attention soutenue et cela plusieurs heures de suite, sous peine de causer des avaries à la marchandise ou de faire blesser un arrimeur qui travaille dans la cale à l’aplomb du panneau. Et comme le mousse n’est pas en bordée ni astreint au quart de nuit, sa journée débute à 4 heures du matin. En réalité, conclut la Revue Générale de la Marine Marchande, ce qui rend digne d’intérêt et de pitié la vie du mousse, ce ne sont pas les mauvais traitements qui finalement sont rares, mais le travail pénible auquel il est astreint et après tout oui… pourquoi ne pas supprimer les mousses et les remplacer par des novices. Le nouvel apprenti recruté à 16 ans resterait dans cette situation 2 ou 3 ans avant de devenir matelot puisque la loi n’impose au matelot, en dehors de la condition d’âge qui est 18 ans révolus, que deux voyages au long-cours, ou 18 mois de navigation ou encore 2 ans de petite pêche. À 18 ans le novice pourrait donc devenir matelot léger. Ces nobles considérations n’entreront pas dans les faits car jusqu’à la fin de la voile commerciale, on trouvera des mousses à bord des grands voiliers et on en trouvera dans la Marine Marchande jusqu’à la scolarité obligatoire à 16 ans.
Claude Michel Briot source escales maritimes
Sources citées dans le texte.
• Légende : la photo de ces deux mousses a été prise sur le 3-mâts Marthe le 6 août 1901. Photo envoyée par Michel Jacques Maurin, petit fils de Cap-hornier.